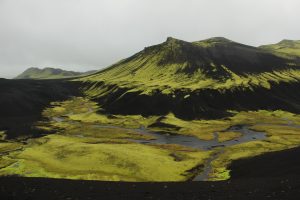» Et s’il nous arrive parfois de nous approcher du mystère de la création, c’est à ces traces et à elles seules que nous le devons »

Contrairement aux apparences, ce n’est pas de métaphysique dont nous parle ici Stephan Zweig, pas plus qu’il n’évoque le site Traces comme voie d’approche au mystère des origines… Non, c’est du mystère de la création artistique dont il est question. Comment accéder au secret de l’acte créateur qui semble se dérouler exclusivement derrière le mur du cerveau de l’artiste, nos sens n’étant pas alors en mesure de le surprendre? D’après Stéphan Zweig, il reste la possibilité d’approcher ce mystère par un moyen qui relève en un certain sens de l’Archéologie, en utilisant les traces que l’artiste laisse au long de son cheminement créatif. Voir sur le même sujet: Bataille-sur-la-creation-artistique; James ou la dégradation de la Cène
La citation qui suit a été envoyée par notre collaborateur Gaston. Qu’il en soit vivement remercié !
« … La création est un acte invisible, qui se déroule derrière le mur du cerveau, et à lui seul le vieux mot d’inspiration – inspiratio – exprime avec une parfaite clarté qu’il s’agit uniquement de « souffle », et donc d’un processus complètement immatériel, que ni les yeux terrestres, ni l’oreille terrestre, ni le toucher ne sont en mesure d’épier. En soi, le diagnostic est juste. Ce qu’il y a de proprement créateur, l’élément visionnaire, l’acte inspiré est invisible chez l’artiste. Mais nous vivons dans un monde terrestre et nous sommes des êtres humains qui ne pouvons saisir les choses qu’avec l’aide de nos sens. (…) Pour qu’une mélodie soit une mélodie pour nous, il ne suffit pas qu’elle s’élève à l’intérieur d’un créateur, il faut que nous puissions l’entendre, un tableau n’est un tableau que lorsqu’il est visible et achevé, une idée n’est une idée qu’à partir du moment où elle est formulée, une sculpture n’est une sculpture qu’à partir du moment où elle se présente sous sa forme définitive. Pour quitter l’âme de l’artiste et entrer dans notre vie, l’inspiration doit donc à chaque fois revêtir une forme terrestre, permettant une perception optique ou acoustique. Elle doit obligatoirement être transmise par un moyen matériel. Même le poème le plus sublime doit, pour nous parvenir, être d’abord fixé avec un élément matériel (…). Le processus artistique – et c’est un nouveau pas dans notre investigation – n’est donc pas de l’ordre de l’inspiration pure, ne se restreint pas à ce qui se passe derrière le mur du cerveau et sur la rétine de l’œil, c’est un acte de traduction permettant le passage du monde de l’esprit à celui des sens, de la vision à la réalité. Et puisque cet acte, comme je viens de le montrer, se déroule principalement dans le matériau sensible, il laisse par là même des traces substantielles, qui remplissent l’état intermédiaire entre la vision incertaine et l’achèvement définitif. Je veux parler des travaux préparatoires, des études des musiciens, des ébauches des peintres, des versions successives des poètes, des manuscrits, tous les matériaux disponibles provenant de l’atelier. Et justement parce que ces documents laissés derrière lui par l’artiste sont des témoins muets, ce sont les plus objectifs, les seuls sur lesquels nous puissions prendre appui. De même que les objets précipitamment abandonnés par l’assassin sur les lieux de son crime et les empreintes digitales qu’il a laissées, constituent les preuves les plus fiables en criminologie, les études préparatoires et les ébauches laissées par l’artiste à la suite du processus de production nous fournissent les seules possibilités d’en reconstituer le processus intérieur. Elles sont le fil d’Ariane, que nous devons suivre à tâtons si nous voulons retourner dans un labyrinthe qu’il est sans elles impossible d’explorer. Et s’il nous arrive parfois de nous approcher du mystère de la création, c’est à ces traces et à elles seules que nous le devons« . (pages 22 à 25)
Source : Stefan Zweig « Le Mystère de la Création artistique » (« Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens »), traduit de l’allemand par Dominique Tassel ; Pagine d’Arte, 2021 (6ème édition).