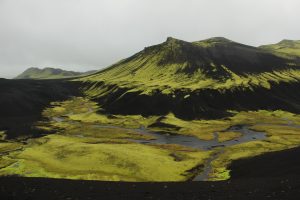« (…) un cheval avait été projeté les quatre fers en l’air, étant coincé entre les deux poteaux mais vivant. Il donnait des ruades pour essayer de se relever. De temps en temps, je sentais le poil de sa queue me retomber sur la tête. »
 Un médecin parisien a fait parvenir à Traces le récit de guerre d’un soldat français de la deuxième guerre mondiale. Un document inédit, d’intérêt historique et de valeur humaine. Prisonnier en 1940, ce soldat raconte avec des mots simples, mais parfois expressifs, sa déportation en Allemagne, ce qu’il a vu, une fois libéré, derrière les lignes soviétiques en Lituanie, enfin, son retour en France. Vu le caractère exceptionnel du texte, on en propose ici de longs extraits. En commençant par le récit de la dernière bataille avant la captivité.
Un médecin parisien a fait parvenir à Traces le récit de guerre d’un soldat français de la deuxième guerre mondiale. Un document inédit, d’intérêt historique et de valeur humaine. Prisonnier en 1940, ce soldat raconte avec des mots simples, mais parfois expressifs, sa déportation en Allemagne, ce qu’il a vu, une fois libéré, derrière les lignes soviétiques en Lituanie, enfin, son retour en France. Vu le caractère exceptionnel du texte, on en propose ici de longs extraits. En commençant par le récit de la dernière bataille avant la captivité.
Nous avons laissé l’introduction et les annotations au texte faites par notre correspondant (en couleur verte).
Ce texte, que j’ai photocopié avec son accord, m’a été montré par l’un de mes patients, il y a maintenant 40 ans. Il s’agissait d’un petit monsieur, vivant seul, dans un rez de chaussée à Vanves, invalide et atteint de nombreuses pathologies, y compris du fait de ses années de captivité. Sans aucun doute, c’est le seul texte que ce monsieur aura jamais écrit de sa vie. Et C’EST sa vie. J’en ai corrigé quelques fautes, restauré une ponctuation absente et séparé les paragraphes, mais seulement pour le rendre plus aisément lisible. La syntaxe est respectée…chaque fois que possible. J’ai parfois dû rajouter des mots manquants: (…), restituer les noms de lieux (pas tous retrouvés) ou donner des corrections ou des précisions. Ce texte me semble résumer assez bien ce qu’a pu être cette guerre pour quelques dizaines de millions de “petites gens”, à l’œil finalement assez aigu pour “tout” voir, mais à leur façon. Le témoignage d’un simple quidam, qui a été témoin d’événements majeurs à son insu, étant présent par le plus grand des hasards à l’endroit et au moment où se produisaient des événements qui allaient marquer notre Histoire. Un “journal du soldat” sans doute peu fréquent.
« 14 mai 1940. A la sortie de Monsageon, Aisne, à environ 1 km. (Il s’agit probablement de Mont Saint Jean, à la limite des Ardennes. Il se dirige donc vers le sud, c’est à dire qu’il fuit le front, qui a été percé. Ce régiment était stationné dans la ligne Maginot).
« Tout le long de la route, ce n’est que des cadavres et des débris de matériel plein les fossés dont les arbres ont été coupés au ras du sol et sur un, je vois un commandant de chasseurs à pied qui casse la croûte et pleure en nous voyant prendre la direction de Bruhamel (sans doute Brunehamel) où nous ignorions que nous allions nous trouver devant plusieurs centaines de chars et automitrailleuses. “Pauvres pionniers avec pour simple défense des Lebel et quelques fusils mitrailleurs modèle 1916 modifié”.
« A l’entrée de Bruhamel, je me trouvais en tête de la colonne comme infirmier, en face la rue transversale. Une ficelle de lieuse était tendue pour barrer la route.
« Aussitôt, de la maison abritée derrière ce mur de 2 mètres à gauche de la rue, une fusillade très nourrie éclate après avoir fait la sommation « français, rendez-vous ou nous ouvrons le feu », auquel répondent les pionniers du 460 ainsi qu’un régiment d’algériens qui comme nous faisait le sauve-qui-peut (il peut s’agir de spahis ou de tirailleurs). Un canon anti-char fut mis en batterie ainsi qu’un canon de 75 mais hélas, il n’y avait que 10 obus pour le canon anti-char et pas du tout pour le canon de 75 et ces dix obus anti-chars ont servi à détruire 4 tanks plus un camion de munitions qui suivait les chars.
« Devant le manque de munitions, les chars allemands sortent des rues transversales de la Mairie en tirant au canon et à la mitrailleuse. Etant sans défense, ce fut un vrai carnage.
« Moi-même, je me suis couché dans le fossé de gauche et en face de moi entre deux poteaux téléphoniques, un cheval avait été projeté les quatre fers en l’air, étant coincé entre les deux poteaux mais vivant. Il donnait des ruades pour essayer de se relever. De temps en temps, je sentais le poil de sa queue me retomber sur la tête.
« A quelques mètres au milieu de la route se trouvait une charrette chargée de pelles et de pioches attelée de deux chevaux. Comme c’était un obstacle à la progression des tanks, un tank s’est mis à gravir par le milieu de la charrette qui s’est aplatie comme une feuille à cigarette. Les chenilles d’un autre tank sont passées sur les deux chevaux, ce qui les a complètement coupés en deux comme un rasoir. Le sang coulait jusque sur ma capote, étant couché dans le fossé à quelques mètres d’eux.
« Derrière les chars d’attaque qui progressaient vers Monsageon, il y avait l’infanterie qui faisait le nettoyage. C’est-à-dire (que) tout ceux qui pouvaient marcher prenaient la direction de la Mairie par la rue transversale et tout cela sous les balles et les huées des allemands qui étaient aux trois quart saouls. Le premier que j’ai vu de près, sa première parole fut « chouanerie françouse » (schweinehund, plutôt?), cochon de français. Mais en même temps (il) me coupait les bretelles des musettes que je portais et les mettait toutes en tas, me fouillait, me prenait ce qui lui plaisait et me donnait l’ordre de suivre mes camarades à la Place de la Mairie.
« Grande fut ma surprise en y arrivant. Tout était plein de soldats comme moi, là depuis la veille. Là, nous nous sommes regroupés par régiments et sur notre compagnie, sur 222, à l’arrivée à Bruhamel, nous ne (nous) sommes retrouvés que 33 et ceci en l’espace d’une heure. » (Ce qui ne signifie pas que tous les autres ont été tués : beaucoup ont pu s’échapper avant d’être pris).
{…}
« Pour mon compte, j’avais une paire de chaussures un peu étroites. Dès le lendemain je n’ai jamais pu les remettre tant j’avais les pieds enflés. C’est un camarade qui m’a donné une paire de ses savates en corde qui du reste ne m’ont jamais quitté jusqu’à ma triste arrivée au Stalag 1B (abréviation de Stammlager: camp ordinaire ; le Stalag 1B a accueilli environ 650 000 prisonniers en 4 ans, dont 55 000 y sont morts) à Holenstein (en fait: Hohenstein, en Prusse Orientale ; aujourd’hui Olsztynek, en Pologne).
« Il nous fallait marcher nuit et jour sans manger et rien à boire que quelques flaques d’eau dans les ruisseaux, toute boueuse. Une nuit, à huit, nous avons voulu nous reposer à côté de la route dans un petit bosquet un peu avant Rosoy (Rocroi ?), mais dix minutes ne s’étaient pas écoulées que les chiens nous faisaient sortir à coups de crocs.
« Il nous fallut reprendre la route jusqu’à Rosoy accompagnés par les coups de crosses des gardiens. Malheur à celui qui était en queue de colonne car ne pouvant suivre, il était sûr d’avoir le coup du lapin c’est-à- dire une balle dans la nuque, ce qui arrivait très souvent.
« Tant bien que mal, je suis arrivé avec la colonne jusqu’à Charleville (-Mézières, dans les Ardennes), mais avant, nous avons traversé Liard (Liart, dans la forêt des Ardennes) où une bataille venait de se dérouler (En fait, il s’est trouvé exactement dans la zone où les combats ont été les plus féroces et les plus longs, là où un certain colonel De Gaulle s’était illustré par sa résistance. C’est la bataille dite de Montcorne).
« Tout y était rasé : la gare, etc. Mais hélas beaucoup de cadavres étaient encore sur le terrain tout au bord des routes. Des civils les relevaient en les portant dans des couvertures, c’était leur seul linceul.
« Je me souviens d’avoir vu un cadavre et sur sa poitrine sa plaque militaire au nom de Rollin, Clermont-Ferrand. »
{…}
« De là nous sommes passés à Gespronsard (Gespunsart, à la frontière), le dernier pays de France. Après, c’est la Belgique et j’ai trouvé un litre à bière vide avec bouchon automatique. J’ai pris les bretelles d’une musette à gaz et chaque fois que je trouvais de l’eau, j’en remplissais cette bouteille que je n’ai jamais quittée jusqu’à mon arrivée au camp d’aviation comme forte tête de Rosken (Roskenheim, en Prusse orientale ?). C’est peut-être cette réserve d’eau qui m’a sauvé l’existence car je n’en buvais qu’une gorgée à la fois.
« Traversons Gespronsard pour arriver à Bouillon où nous passons la nuit sur un terrain plat où se trouvait une gare de petit train, mais il n’y avait que quelques wagons. La colonne s’est reposée comme elle a pu. Moi, je me suis allongé sous un wagon car il pleuvait cette nuit-là.
« Réveil à 5h, départ en direction de Neuchateau (c’est Neufchateau) mais dans la traversée de Bouillon pour traverser la Semois (c’est le nom de la rivière qui traverse Bouillon), les ponts étant sautés, il fallait passer à la file indienne sur des passerelles, ce qui nous a fait attendre plusieurs heures sur les bas-côtés de la route.
« Une petite femme belge âgée d’au moins 70 ans faisait les distributions de quelques morceaux de pain qu’elle avait dissimulés dans sa banette, c’est-à-dire un grand tablier mais malheureusement un gardien l’avait aperçue et s’étant approché d’elle lui demande ce qu’elle faisait avec les prisonniers. Devant le refus de la pauvre femme, il l’empoigne par les cheveux et les jambes et par dessus le bord de la Semois, l’envoie dans l’eau à cet endroit.
« Je ne sais pas la suite de ce qu’il en advint car mon tour était arrivé de passer la Semois pour Neuchateau que nous traversons sous l’œil des civils qui n’ont rien à manger non plus et ne peuvent rien faire pour nous. »
{…}
« Enfin, le lendemain, nous arrivons à Trèves. Débarquement d’où l’on nous conduit à coups de crosses jusqu’au camp qui se trouve tout en haut d’une colline.
« En plein midi, la montée est rude, surtout pour nous vu notre état de faiblesse extrême. Nous sommes mis dans des baraques par 200 mais là, la Providence me suivait.
« A l’endroit où je me trouvais dans la baraque, je remarquais une planche pas clouée comme les autres. Je la soulève avec la pointe d’un couteau.
« Quelle ne fut pas ma surprise d’y trouver plein de grains de maïs. J’en ai empli toutes mes poches et de temps en temps, j’en mettais quelques grains dans ma bouche puis j’attendais qu’ils soient bien gonflés et je les croquais. La faim, c’est terrible. »
{…}
« Nous avons voyagé à 80 par wagon à bestiaux pendant cinq nuits et quatre jours complets, portes cadenassées et avec de temps en temps l’écho d’arrivée de cailloux sur les wagons. C’est ainsi qu’en passant à la gare de Köpenik à côte de Berlin, un camarade a reçu une balle de revolver dans les reins et en est mort deux jours après son arrivée au camp du Stalag 1B à Hohenstein.
« Nous arrivons à la petite gare d’Hohenstein le 29 mai vers midi. Sur le quai, il y avait tous les mètres un gardien avec un gros gourdin pour faire activer la descente. Et le départ pour le camp très rapidement. Malheur à celui qui ne pouvait pas suivre: il était voué à une mort certaine.
« D’ailleurs, à l’arrivée de chaque convoi, il y avait toujours un grand tombereau spécial pour emmener les morts directement au cimetière et ces mêmes tombereaux servaient à passer dans les îlots des camps pour ramasser les cadavres de la nuit.
« De la gare, nous allons directement au camp, distant de 2 kilomètres (ancienne route). Je fus affecté dans le groupe d’îlots N° 13-14-15-16 à la baraque 14. Alors commença notre vrai calvaire de « gefang » (krieg-gefang: prisonnier de guerre). »
{…}
« Le 31 juillet, avec une trentaine de camarades, je fus désigné pour changer. On m’embarqua pour aller à Lyck (en Prusse Orientale, aujourd’hui en Pologne: Elk), à côté de la frontière polonaise. On me plaça dans une fermette où il y avait deux chevaux, deux vaches et le patron, maréchal ferrant. Le soir, on rentrait coucher au laguer (lager: camp).
« Nous avions la visite du gardien tous les jours mais nous n’en avions plus pour nous garder. Le patron où j’étais placé avait fait la guerre 14-18. Il n’était pas costaud, d’ailleurs. Heureusement, car à la forge il m’aurait fait crever, moi qui n’avais jamais fait … Il est mort six mois après. La forge fut fermée et je pouvais faire le petit boulot des camps moi seul, tranquille. (Voir ou revoir le film « La vache et le prisonnier»).
« Dans cette famille, il y avait une fille et quatre garçons : deux soldats d’ailleurs très chics, un de 4 ans, mais le 3è, de 14, un vrai hitlérien qui voulait me commander. Ma foi, nous n’étions jamais d’accord. La patronne aurait bien voulu me faire traire les deux vaches, mais comme j’en avais peur, je ne l’ai jamais fait. Ce qui m’évitait d’y retourner le dimanche soir, ce qui fait qu’à partir de 13h , j’étais libre jusqu’au lendemain 6h alors que tous mes copains étaient obligés d’y aller le soir.
« Moi, j’allais à la pêche en fraude et je changeais le poisson pour du tabac ou des cigarettes. »
{…}
« J’y suis resté jusqu’à l’alerte de l’arrivée des russes. Pour Noël 44 (43, probablement), ma patronne me fait remarquer qu’il n’était pas tombé de neige et me dit « kein schein, Deutschland kaput », (en fait: keine schnee: pas de neige), ce qui veut dire « il n’est pas tombé de neige à Noël, l’Allemagne est vaincue ». Ce qui fut vrai par la suite.
« Le 8 janvier 44, ordre est donné de préparer les chariots et traîneaux en vue d’une émigration prochaine. Je vais donc chercher des plaques de contreplaqué à Lyck et j’en fais un toit en les mettant en arc en ciel (de cercle ?) sur le chariot. Mais déjà, les russes ne sont pas loin. Toutes les nuits, les avions nous bombardent et même en plein jour. Ce n’est pas prudent de rester en ville. Un jour, me trouvant à la gare de Lyck pour y conduire un cochon, un avion nous a mitraillés en rase-mottes et avec des roquettes. Il y a eu au moins 25 victimes dont deux prisonniers français tués sur le coup. » (À noter que la date et le lieu correspondent aux raids des aviateurs français de l’escadrille Normandie-Niemen…)
{…}
« Traversons une grande forêt qui est déjà dépassée par les russes. À la sortie, nous nous trouvons complètement dans la ligne de feu à Beschften (Bischofstein, à mi-chemin de Kalinigrad. Aujourd’hui Bisztynek) le 29 janvier 44. Impossible d’aller plus loin, c’est aller à la mort. Ce ne sont que des tanks qui brûlent ainsi que les maisons et des tas de cadavres surtout civils, les uns sur les autres tout le long de la route. Voyant une petite maison, je me dirige dedans avec le chariot et dis à ma patronne « voilà les guides des chevaux. Moi, je reste là ». À peine un quart d’heure après, il y avait plus de 50 personnes dans cette maison. Il en venait de partout : des polonais, des russes, des italiens, tous des déportés ou prisonniers comme nous. Cela n’avait pas ralenti la bataille car dans Bischofstein, il y avait un régiment d’artillerie boche qui tirait toujours. Il a fallu que les tanks nous mettent tout à feu et à sang pour en venir à bout, ce qui demanda 24h.
« Je vois pour la première fois un russe de l’armée qui se présente dans la cour avec sa « boîte à camembert » ou mitraillette (c’est le PPSh-41). Son premier travail est de faire sortir tout le monde, de les mettre sur un rang, y compris nous car nous nous étions retrouvés quatre français. Il n’y a que les ukrainiens qui sont restés. Quand il m’a vu, il m’a empoigné par le bouc et m’a couché dans la neige. Ouvre sa boîte à camembert et m’applique le canon sur le ventre. Par bonheur pour moi, une ukrainienne s’est jetée entre nous deux et lui a expliqué ce que nous étions. Il est redevenu calme, nous a fouillés et gardé nos plaques de prisonniers de guerre qu’il a mises dans sa poche.
« Mais tous les civils allemands furent tous fusillés en cinq minutes. La neige était rouge autour du tas de cadavres, grands comme petits, tout y a passé. (L’accord passé avec les alliés, entre Churchill et Staline notamment, faisait que la Prusse Orientale devait devenir polonaise à la fin de la guerre. Il était donc impératif de chasser -ou d’exterminer- tous les allemands de cette province, comme de la future enclave de Kaliningrad avant l’armistice. Ce qui fut fait).
« Deux heures après, un lieutenant-seigneur (starchïy leïtenant: lieutenant-senior) car dans l’armée russe, il y a trois grades de lieutenant, nous dit en français « il faut prendre cette route, vous grouper et n’y marcher que le jour et jamais la nuit, autrement vous seriez abattus ». Alors, pour nous, commence une deuxième retraite, cette fois en allant sur la Lituanie (vers le nord), qui a duré du 29 janvier 44 au 22 février 44, qui fut très dure, surtout pour la faim et en même temps, c’était le dégel. De la vraie gadoue. »
{…}
« Quelques jours après, nous arrivons à Goldap où s’était déclenchée la grande attaque russe. C’était un vrai carnage, il fallait prendre les champs, les routes étant minées, et escalader les cadavres.
« C’est à partir de là que j’ai vu, ainsi que mes camarades, les orgies commises par la guerre: les premières femmes avec les jupes relevées sur la tête, les jambes très écartées laissant voir toute leur nudité. Il n’ y avait pas de doute qu’elles avaient été violées, car sur certaines, on voyait encore le sperme congelé dans les poils. Et comme remerciement, une balle dans la nuque.
« Et cela était chose très courante. Quand aux hommes, en partie des vieillards, ils étaient déculottés et la verge soit coupée ou fendue ou même les parties et laissés sur place, le tout congelé. » (L’avancée des troupes soviétiques: officiers russes et troupes asiatiques, a donné lieu à d’innombrables crimes de guerre, les premiers répertoriés durant ce conflit. Une explication au laissez-faire officiellement toléré durant des semaines a été la volonté de revanche. En fait, il s’agissait d’une décision politique).
{…}
« Nous continuons notre retraite en voyant toujours les mêmes tableaux. Horreurs de la guerre. De Rastenburg (Ketrzyn) jusqu’à Mihounen (en Lituanie, non retrouvée), les routes que nous prenons ne sont que de simples chemins de sable bordés quelquefois par des saules mais hélas toujours le même spectacle des horreurs de la guerre qui ne se termine pas car, dans les fossés, par place, les cadavres sont les uns sur les autres. (Les lituaniens affirment que tous les allemands, entre autres, rattrapés par les troupes soviétiques ont été abattus sur place). À notre arrivée à Mihounen, nous sommes parqués dans une grange à tous vents sans paille, mais pour la première fois, nous touchons des russes des tibias et des têtes de vaches que l’on fait cuire avec les planches prises d’un hangar avoisinant. Ça fait un peu de jus gras, mais de viande, point. Quelques jours après, nous touchons du millet décortiqué. C’était la première fois que j’en voyais. Ma foi, bien cuit, ça remplace l’orge perlé des boches. Nous y restons huit jours.
« De là, nous partons pour Gumbinnen (Goussev ou Gusev aujourd’hui, dans l’enclave de Kaliningrad). Les ponts étant sautés, nous nous sommes tapé 72 km pour faire 12 km en ligne droite en deux jours. À notre arrivée à Gumbinnen, nous sommes logés dans des casernes boches mais tellement serrés qu’il nous est impossible de se coucher sur le dos. Il faut se mettre de côté l’un contre l’autre. Et toujours rien à manger avant deux jours. Le repas au bout des deux jours consiste en sauté fait avec les têtes et les panses des animaux abattus, car la viande était réservée pour l’armée, et pour nous le reste. Mais à Gumbinnen, il nous fallait travailler, soit sur les rails ou enterrer les cadavres, humains comme bestiaux, car il y avait beaucoup de bétail mort dans les prairies et déjà au mois de mars, ça ne sentait pas la rose. D’autres allaient récupérer le mobilier dans les maisons encore debout. Mais fallait prendre d’abord des pelles et des tinettes car tous les rez de chaussée avaient servi de WC à la troupe russe et comme le papier chez eux est inconnu, c’est avec des paquets de paille qu’ils se torchent le derrière, ce qui fait un vrai tas de fumier qui sent son goût.
« Le 25 juin, l’on nous réunit sur le terrain face au moulin à côté du puits artésien. Tout le bloc N°3 où un général russe nous fait un discours nous retraçant tous les liens amicaux datant de la Révolution de 1789 et de la Commune de Paris en 1870, espérant que nous n’oublierons pas le bon accueil reçu par eux dès notre retour en France (quel bon accueil ?). Et musique en tête, nous traversons les ruines de Gumbinnen pour embarquer le cœur joyeux d’espoir de revoir la France. »
{…}
« C’était le 4 juillet 45. Nous passons à côté de Brest-Litovsk. De Varsovie, où tout est complètement rasé, pas un mur debout et tout le long de la voie, nous voyons des trains entiers renversés dans les fossés. Cela pour l’écartement des voies. Les voies russes étant plus larges, ces wagons ne pouvaient plus se servir de ces voies.
« Mais par endroits, nous voyons encore des cadavres non ensevelis, mais chose curieuse, ayant été congelés, qui se sont vidés tout doucement: il n’y reste plus que la peau et les os et les habits. Ils s’étaient complètement vidés de tout liquide. À Varsovie, nous commençons à voir les premiers civils rentrés chez eux, dans des espèces de huttes qu’ils s’étaient fabriqués pour s’abriter car il n’y avait plus une seule maison debout. Mais à chaque arrêt de train, des centaines de personnes se présentent avec toutes sortes de choses pour faire du commerce. »
{…}
« De là, nous sommes emmenés à Habursdorf (Werlaburgdorf, plutôt) où nous sommes remis aux anglais en échange de déportés russes. (Les déportés russes, faits prisonniers au combat, considérés comme « déserteurs » et supposément traîtres par Staline, ont pour beaucoup rejoint le goulag sans même descendre du train…). Nous sommes dans une baraque où furent logés des prisonniers français travaillant à la mine à ciel ouvert de « grün kolen » c’est à dire à du charbon jeune (« grün kohle »: le lignite?), qui n’est pas encore fait, mais à ciel ouvert.
« Ces baraques sont isolées par des barbelés de 2 mètres de haut et entre chaque baraque, une grande épitaphe disant ceci « tout prisonnier étant surpris dans les barbelés sera fusillé sans avertissement ».
« Dans la baraque à côté de la nôtre, ce n’est que des femmes ou filles qui ont suivi l’armée allemande dans leur retraite. (Sans doute un certain nombre de françaises parmi elles…). Et parmi elles, il y a l’air d’y avoir de jolis tableaux car leur langage n’est pas très honorifique pour elles. Au bout de trois jours, on nous fait monter la côte qui nous fait monter à la mine. Et là, nous embarquons dans des wagons à bestiaux, mais quelle ne fut pas notre surprise de voir que les deux derniers wagons étaient réservés pour ces dames. Mais devant l’attitude de tous les prisonniers français, les anglais les ont ramenées au camp. Je ne sais pas ce qu’il en est advenu. » (Ces femmes que les anglais voulaient rapatrier en même temps que les prisonniers français étaient françaises et belges : emmenées dans le paquetage de soldats de la Werhmacht dont elles étaient le couple, elles en avaient été séparées, de force la plupart du temps, et avaient un statut de « prisonnières »).
{…}
« Finalement, après un petit casse-croûte, nous embarquons de nouveau, cette fois pour Paris. À 22h le soir, nous touchons du bouillon Kub à Saint-Quentin et arrivons à la Gare du Nord à 5h du matin. À la descente du train, nous passons dans une haie de gardes mobiles. À la sortie, des autobus nous ont conduits à la caserne de Reuilly. Le premier guichet que je fais en montrant mes papiers, on me déclare « Va t’en, tu es de la Seine. Tu es arrivé ». (Le département de la Seine n’a été démembré qu’en 1968). Je reprends mes musettes, je sors dehors, me dirigeant vers le métro Reuilly que je prends pour rentrer à Vanves par Petits Ménages (la station de métro « Corentin Celton », de nos jours, à Issy les Moulineaux). Au portillon, le préposé me dit « Monte en première, tu auras de la place ». Ce que je fis, mais quelle ne fut pas ma surprise en voyant tous les voyageurs s’écarter de moi. J’en entendis une chuchoter « Qu’est-ce qu’il doit avoir comme poux ».
« Je tiens à signaler qu’en effet, je n’étais pas très beau car depuis ma capture, je ne m’étais pas rasé. Donc, j’avais un bouc bien noir d’au moins 40 cm et des moustaches blondes « à la Guillaume », jusqu’aux oreilles. Comme habits, j’avais une culotte kaki avec le bas des jambes bleu horizon, la veste kaki, bleu et gris russe, le tout étant fait de pièces, et une capote kaki, un calot « popov ». Voyez d’ici la tenue un peu romanesque.
« Enfin, à 6h30, je me présente chez moi, mais comme au premier de la rue Normande, ma femme y habitant seule, je trouve la porte fermée, impossible de rentrer.
« Je monte la rue Normande où je reconnais Mr Durot, celui qui tenait le café avant guerre où je bois un bon rhum pour me remettre de mes émotions. Je vais pour aller voir ma sœur, qui habite au 11 de la même rue, mais le cœur bien gros. Ceux qui viennent m’ouvrir, ce sont des nouveaux locataires. Pendant la guerre, ils avaient déménagé.
« Je retourne au café où Mr Durot va prévenir ma sœur qui, me voyant, a refusé de m’embrasser tant j’étais laid avec cette barbe. Tout de même, avec des petits cailloux dans la fenêtre, ils ont réveillé ma femme, qui est venue me chercher, qui aussi a refusé de m’embrasser, mais moins d’une heure après, tout était net après la coupe aux ciseaux. Le rasoir a fait peau neuve.
« La vie recommence. »